Le jaïnisme, l’une des plus vieilles religions du monde, a un credo essentiel : la non violence.
Ses origines se perdent dans la nuit des temps. Antérieur au bouddhisme et à l’hindouisme, certains érudits le font remonter aux temps pré-historiques. Gandhi en fut un adepte.
L’anekāntavāda est, dans le jaïnisme, une pensée fondamentale pour appréhender les choses et pourrait se traduire par « relativité (ou non-absolutisme ) de la réalité ». « Anekānta » signifie « multiplicité » et « Vada » désigne «une école de pensée, une doctrine». On peut encore dénommer l’anekantavada : «doctrine de la non-exclusivité»
Il fait référence à deux doctrines : nayavada concernant la réalité de points de vue multiples et syadvada concernant les points de vue à plusieurs facettes et donc la relativité des objets et des êtres dans l’espace et dans le temps.
Théorie de la tolérance, il encourage l’acceptation du relativisme et le pluralisme.
Doctrine du nayavada
Suivant la philosophie jaïne, ce qui peut être objet de connaissance est d’une complexité infinie : c’est une pluralité pouvant faire l’objet de points de vue multiples et qui ne peut donc être vue de manière monolithique, en une seule fois et d’une seule manière.
La « réalité » d’une personne dépend du point de vue d’où elle se place. Par exemple, si je me place du point de vue de la France, ma conception de l’âme n’est pas la même que si je me place du point de vue de l’Inde. Et pourtant, c’est le même mot « âme » que j’emploie. Ou encore, je vais comprendre différemment un même évènement à un moment donné selon que je suis historien, sociologue, politologue, ethnologue, etc.
Nous ne pouvons pas saisir la totalité des points de vue. Nous percevons d’abord avec nos sens et sommes, dans nos modes de connaissance, limités et conditionnés par eux ; ce qu’ils perçoivent ne peut être que partiel.
C’est ce qu’illustre la parabole des « aveugles et de l’éléphant » rendue célèbre par le poète américain John Godfrey Saxe au XIX ème siècle : sept aveugles dont chacun, ne touchant qu’une partie de l’éléphant, l’appréhende selon ce qu’il ressent et le décrit donc selon ce seul critère. Ainsi, pour l’un, c’est un mur. Pour l’autre, touchant une défense, c’est une lance. Celui touchant la trompe dit que c’est un serpent ; pour qui touche l’oreille, un éventail, etc. Chacun ne décrit donc qu’une partie et en fait un tout.
Un jaïn, le Professeur Sagarmal Jaïn use d’une autre image : « Nous pouvons, par exemple, faire des centaines de photos d’un même arbre, sous différents angles. Bien que toutes donnent une image exacte de cet arbre, elles sont pourtant toutes différentes. Chacune ne peut donner une image complète de l’arbre. Toutes, non plus. Individuellement ou ensemble, elles ne donnent de cet arbre qu’une vue partielle.
Tel est aussi le cas de la compréhension et de la connaissance humaines. Nous ne pouvons avoir qu’une image partielle ou relative de la réalité ; nous ne pouvons la décrire et la connaitre que sous un certain angle, d’un certain point de vue. (…) Certes, nous ne pouvons mettre en doute la validité ou la valeur de l’image, mais nous devons être, en même temps, conscients que ce n’est qu’une vérité partielle, qu’un point de vue subjectif. »
Avec cette multiplicité de points de vue, chacun ne peut décrire que sa perception d’une certaine réalité à un moment donné. Le problème, c’est quand on croit détenir toute la vérité et n’en détenons qu’une partie.
Toutes ces manières particulières d’exprimer une chose s’appellent des nayas. Décrire la réalité, à partir de ces points de vue, prend le nom de nayavada ou doctrine des nayas. La totalité d’une réalité n’est pas exprimable car toujours complexe et multiforme et requérant infiniment de réponses.
Nayavada n’est pas une simple argutie intellectuelle. C’est une position contre un dogmatisme absolu ; il ne peut à proprement parler y avoir de batailles d’idées. Cela ne peut qu’ouvrir à la tolérance et une meilleure compréhension de ce qui nous est étranger
Tous ces points de vue pourraient, ensemble, définir une réalité. Mais ils sont si nombreux ! D’où l’essai d’en faire une synthèse et la doctrine du syadvada.
La doctrine du syadvada
Comprendre qu’il existe des points de vue différents ne suffit pas. Cela doit aussi pouvoir être exprimé de façon exacte et correcte.
Aucune affirmation simple ne pouvant exprimer la totalité d’une complexité, le jaïnisme a eut recours au mot syad, qui signifie « peut-être ». En l’ajoutant systématiquement aux diverses affirmations concernant la réalité, il a pris le sens de « à certains égards », « d’un certain point de vue », « dans un sens », « d’une certaine manière ».
Les philosophes du jaïnisme ont ainsi formulé sept propositions pour décrire une réalité. Aucune n’est absolue, toutes sont relatives mais toutes partiellement vraies selon le point de vue, même si elles peuvent sembler contradictoires.
- « syad-asti » : d’une certaine manière, c’est,
- « syad-nasti » : d’une certaine manière, ce n’est pas,
- « syad-asti-nasti » : d’une certaine manière, c’est et ce n’est pas,
- « syad-avaktavya » : d’une certaine manière, c’est indescriptible,
- « syad-asti, avaktavya » :d’une certaine manière, c’est et c’est indescriptible,
- « syad-nasti, avaktavya » : d’une certaine manière, ce n’est pas et c’est indescriptible,
- « syad-asti-nasti, avaktavya » : d’une certaine manière, c’est et ce n’est pas et c’est indescriptible.
Formulé ainsi, ce n’est pas compréhensible. C’est souvent expliqué avec l’exemple suivant : un homme est le père ; il n’est pas le père, et il est les deux. Pour éclaircir, imaginons Jean avec son ami Paul et Monsieur X
- Par rapport à Jean, Monsieur X en est le père (« syad-asti »).
- Mais, par rapport à Paul, Monsieur X n’est pas le père (« syad-nasti » ).
- Par rapport à Jean et à Paul, pris ensemble, Monsieur X, à la fois et au même moment, est le père et il n’est pas le père. Comme les deux idées ne peuvent pas s’exprimer par des mots en même temps, il peut être appelé indescriptible, puisqu’il est le père et il n’est pas le père, ainsi de suite…
Ces affirmations ne sont pas contradictoires si l’on a pris la précaution de bien comprendre le point de vue à partir duquel elles sont exprimées.
Cette doctrine représente donc une vue très sensée des choses en exprimant les différents points de vue particuliers. En transformant notre façon de penser, nous pouvons également modifier notre ressenti par rapport aux événements. Nous voyons alors les choses sous un nouvel angle et de plus, nous pouvons agir différemment de ce que nous aurions fait avec nos anciens schémas de pensées.
L’intérêt pratique de ces doctrines
La doctrine du « syadvada » a un intérêt pratique. En montrant que personne ne détient le monopole de la vérité, elle aide à combattre le sectarisme. Elle vise donc à ne pas propager de violence, en pensée, en paroles ou en actes. La non-violence est bien la mission première du jaïnisme.
Cette doctrine peut s’appliquer à tout, à propos d’un objet, d’une relation, de l’identité d’une personne ou de son caractère, de la vie, de la terre, etc. On peut même l’appliquer à propos de Dieu (cela éviterait tous les conflits ayant une religion comme épicentre).
Elle n’est pas une simple spéculation intellectuelle Par exemple, au niveau personnel, elle implique une remise en question de ses propres convictions. Ce que je dis est-il vrai ? Peut-il être abordé différemment ? Quelqu’un peut-il penser l’opposé avec la même conviction et des arguments tout aussi valable ?
Cela n’a rien d’évident ! Mais c’est peut-être ainsi que nos mentalités peuvent évoluer en enrichissant sa propre perception des choses au lieu de faire se batailler chaque égo croyant avoir raison. C’est le sens des deux citations les plus connues de Gandhi : « Vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde » et « Commencez par changer en vous ce que vous voulez changer autour de vous ».
Evidemment, des critiques sont apparues, estimant que Syādvāda entrainait de l’hésitation et de l’incertitude et même, en certains cas, empêchait de prendre position et d’agir.
Pour les jaïns, l’intérêt est de concilier des points de vue opposés au lieu de les refuser.
Cela permet d’éviter des erreurs d’interprétations et des jugements en forme de condamnation.
Cela permet de ne pas être dogmatique, de développer la tolérance intellectuelle et d’éviter les conflits qui naissent de la différence ou de l’opposition entre des idées et des croyances.
Gandhi avait pris soin de préciser: « Chacun a raison de son propre point de vue, mais il n’est pas impossible que tout le monde ait tort ».
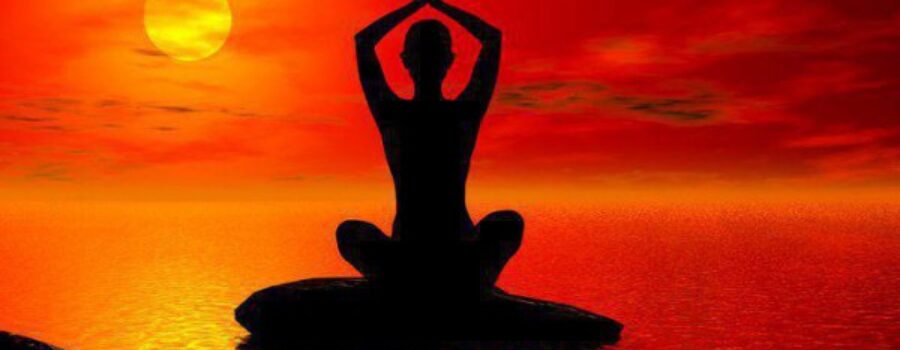


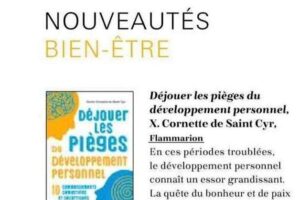
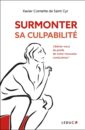
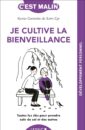
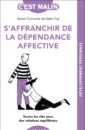
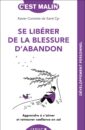
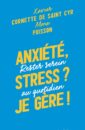
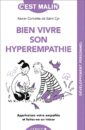


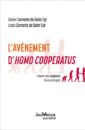


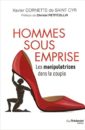
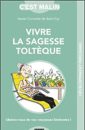








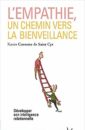


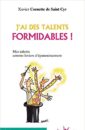
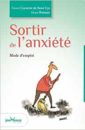


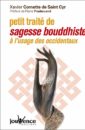

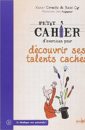


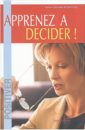


Publier une Réponse
Votre adresse email reste confidentielle.