On ne naît pas perfectionniste, on le devient et cela modèle notre personnalité. Etre perfectionniste, c’est adopter la devise « Sois parfait ! » pour soi-même et/ou pour les autres.
Entre le « sain » et le « toxique », c’est une question de dosage. Le premier dit « Je veux mieux que bien » et le second déclare : « Je veux mieux que mieux ».
Le « sain » et le « toxique »
De quoi s’agit-il ?
Ce qui doit être « parfait » est situé sur un sommet imaginaire qui, déjà, manque de référent : parfait, oui, mais par rapport à quoi ?
Il est ensuite indéfini : à quoi ressemble précisément ce qui est parfait ? Quels en sont ses attributs, ses composants ?
L’une des meilleures définitions vient de l’écrivain Paul Carvel : « Qui veut atteindre la perfection, veut marcher sur l’horizon ». Même en courant très vite, l’horizon recule toujours au fur et à mesure qu’on avance : illustration de la perfection comme idéal abstrait impossible à atteindre car… il est abstrait !
Notre société utilise régulièrement les termes « excellence » et « performance » qui ne sont nullement discutables pour progresser et faire face aux défis rencontrés, quels qu’ils soient : développer une structure, réaliser un dépassement de soi, un épanouissement personnel ou collectif. Ils visent une amélioration et cela commence par une vision… du possible.
Là où le bât blesse, c’est lorsqu’apparaît un effet pervers et que de moyen, la performance devient une fin en soi.
Performance et satisfaction
La performance vise la poursuite du succès : atteindre un objectif, probablement difficile mais réalisable et tangible. Cela procure alors une intense satisfaction, le souhait étant d’accomplir consciencieusement ce qui est à faire et d’éviter des erreurs.
S’il n’est pas atteint, une personnalité saine se réjouit du chemin parcouru. Entre ce qui a été obtenu et ce qui était voulu, il y a un écart mais elle se félicite de la diminution de cet écart. Viser l’excellence permet ainsi de réaliser mieux que bien mais en connaissance de ses propres limites et en sachant mettre un terme lorsque cela est adéquat.
Pas pour un perfectionniste : cet écart devient synonyme d’échec car il se situe au-delà de la saine volonté de réussir. Le perfectionniste suppose un niveau intangible : la perfection ; il fignole à l’excès pour faire mieux que mieux et, partant de là, décrète inacceptable toute erreur.
De surcroît, même si le niveau est atteint, il estime avec une logique très spécifique et un mode de raisonnement particulier qu’il est possible – nécessaire ? obligatoire ? – d’atteindre un degré de plus. Il n’éprouvera alors qu’insatisfaction, quelle que soit la performance accomplie.
Cela ferait même songer à cette chanson de 1964 des Rolling Stones : “I can’t get no satisfaction / Cause I try and I try and I try and I try”. Et au bout du compte, pas de satisfaction….
Quel est l’objectif, précisément ?
Le problème apparait quand on définit mal l’objectif à atteindre. Prenons deux cas de figure courants :
1/ L’objectif est irréaliste, indéfini. A fixer la barre trop haute, on arrive à la confusion du possible et de l’impossible. Le manque de référents est flagrant : on vise un idéal mais c’est quoi ? C’est quoi un couple parfait, un amour parfait, un travail parfait, une conférence parfaite, une vie parfaite, etc ? A quoi ça se reconnaît, se définit, se construit, etc. S’il n’y a pas un objectif précis, on n’arrive à rien. C’est bête à dire et cependant…
2/ L’objectif est atteignable mais est un devoir absolu : « Je ne fais pas par plaisir ; je le veux parce ce que je le dois ». Il est des cas où les sollicitations extérieures sont un déclencheur lorsque l’on prête une trop grande attention aux messages sociaux demandant d’être parfaits.
Aujourd’hui, la performance s’est imposée et est encouragée comme une valeur positive. Tous les records demeurent constamment à battre. Voilà par exemple ce que l’on appelle la Beauté du sport et la grandeur du dépassement de soi. Et c’est vrai : c’est souvent enthousiasmant de s’être dépassé.
Le danger, c’est lorsque la réussite devient obsessionnelle et la performance un culte. Le danger, c’est quand on met en gage la permanence de son être au profit d’une gloire éphémère. Le danger, c’est de se trouver nul et incapable si on n’y arrive pas tout en détruisant son propre outil.
Par exemple, pou se détendre, certaines personnes font du sport mais avec une telle rage pour faire chaque fois mieux qu’elles n’ont plus de plaisir et ne ressentent que la contrainte. On passe ainsi d’un perfectionnisme sain ou positif à un perfectionnisme négatif ou toxique, voire pathologique.
Discerner le « point de bascule »
Lorsque le toujours mieux finit par amener le pire…. Comment discerner ce point de bascule ? Il s’agit avant tout de dosage dans la vision du but, dans la manière d’accomplir et dans la peur que l’on éprouve à ne pas réussir.
En effet, il existe d’un côté ce que l’on veut devenir et accomplir, le but que l’on s’assigne, et de l’autre, ce que l’on est et ce que l’on réalise.
Si l’écart est trop faible, il y a déficit de motivation par manque de défi. Un challenge, dès lors qu’on s’en sent capable, est excitant et motivant. Mais si l’écart est très (trop) grand, on peut refuser le défi car on est découragé à l’avance. Ou bien ramener le but à atteindre à des proportions plus raisonnables.
Tout est subjectif, évidemment, mais pour chaque défi que l’on rencontre ou que l’on se donne, il faut déterminer la hauteur de la marche à franchir. Rappelons-nous, même si on échoue parfois, la phrase d’Einstein : « Je n’ai pas échoué, j’ai trouvé dix mille moyens qui ne fonctionnent pas ». Cela permet d’avancer et de progresser car ce qui est investi est proportionnel à l’importance que l’on attache au but visé.
En revanche, on entre dans le « toxique » si l’on s’entête bien que le but ne soit pas atteignable et se transforme en une affaire « d’honneur », « de vie ou de mort », autrement dit que l’on soit dans une souffrance permanente pour y parvenir et une souffrance déchirante si l’on n’y parvient pas.
La tolérance de l’imperfection plus que la recherche de la perfection est le gage de son bonheur.
La vraie force n’est pas de vouloir la perfection mais de savoir accepter et gérer les imperfections.
Trouver le juste dosage
Mais cela, un perfectionniste « pur et dur » ne peut l’entendre ni même le comprendre. Dans l’accomplissement d’une tâche, effectuer des contrôles et des vérifications est normal et souhaitable mais devenir trop pointilleux est un handicap : la dépense de temps et d’énergie sera disproportionnée. D’où insatisfaction et sentiment d’échec.
Pour reprendre des termes de gestallt, le perfectionniste sain est dans un ajustement créateur : « j’œuvre pour que ce soit mieux » tandis que le perfectionniste toxique est dans un ajustement rigide : « j’arrive au point de bascule et je rends les choses impossibles » et dans ce basculement du bien au mieux puis au pire, on entre de plein pied dans le paradoxe en obtenant l’inverse ce que l’on veut. En fait, comme l’exprime le psychologue François-Paul Cavallier, ce type de perfectionniste « n’est pas rigoureux mais rigoriste ».
Il est donc bien question de dosage mais aussi – et corrélativement – de clairvoyance et de lucidité par rapport à ce qui est actuellement et par rapport ce qui est voulu.
Avoir un idéal ou des normes élevées ne suffit pas en soi à qualifier quelqu’un de perfectionniste. En revanche, il est important de s’interroger sur ce qu’il en est de la tolérance que l’on a pour soi et pour les autres.
Que désire-t-on précisément et vers quoi a-t-on envie de tendre ?
Quel résultat précis souhaite-t-on obtenir ?
Qu’en est-il de la réelle utilité de ce que l’on fait ?
Viser haut est un excellent moteur d’accomplissement, viser trop haut devient diabolique.
Un chercheur d’or espère trouver quelques pépites mais s’il veut mettre la main sur le gisement du siècle, il sera profondément déçu. Le toxique demande que l’on soit réaliste alors qu’il ne l’est pas : il ne voit que le verre à moitié vide mais en réalité, le verre est aussi à moitié plein. Et en plus, il le voudrait complètement plein !
Adopter le principe de réalité
S’affranchir des effets les plus indésirables du perfectionnisme nécessite une approche personnalisée et un travail sur ses propres comportements, croyances et valeurs.[1]
Néanmoins, on peut déjà faire un grand pas tout d’abord en apprenant à inclure du respect et de la bienveillance, tant pour soi-même que pour les autres.
Ensuite, en adoptant le principe de réalité et s’interroger quand on fait ou demande quelque chose : est-ce réalisable ? N’y a-t-il qu’une seule manière de faire ?
Et surtout :
En faire plus est-il utile, nécessaire ?
Quel est précisément le but poursuivi ?
Qu’est ce qui doit réellement être atteint ou obtenu?
Viser haut, certes mais en conservant les pieds bien ancrés dans la réalité.
On peut avoir les yeux tournés vers les cimes mais à condition de conserver de la lucidité dans son regard.
Vauvenargues avait une excellente manière de synthétiser ce point : « La perfection d’une pendule n’est pas d’aller vite, mais d’être réglée. »
[1] Pour retrouver le point d’équilibre et viser un idéal réalisable, voir « Je suis perfectionniste mais je me soigne », Xavier Cornette de Saint Cyr – Ed. Jouvence, 2008



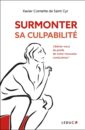
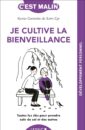
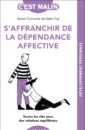
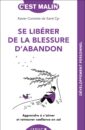
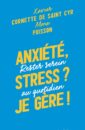
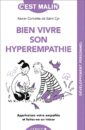


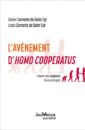


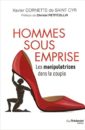
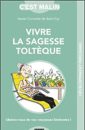








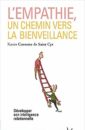


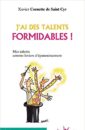
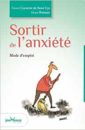


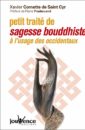

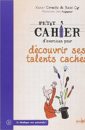


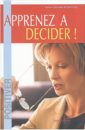


Publier une Réponse
Votre adresse email reste confidentielle.