Nous sommes nombreux à avoir nos écrivains fétiches. Ils ont une force : il y a chez eux quelque chose qui nous séduit dans une manière spécifique de dire les choses et de nous emmener dans leur imaginaire.
En général, après avoir été séduit par quelques ouvrages, on en achète un nouveau sans inquiétude aucune, plein d’a priori positifs et nous régalant déjà, même avant d’avoir lu la première phrase. Il est rare que nous soyons déçu. Cela peut arriver mais on en lira malgré tout d’autres.
Certains romans sont aujourd’hui appréciés quand, à l’instar de beaucoup de films, ils privilégient l’action. Si la vitesse est érigée en qualité, alors l’action et ses rebondissements sont plébiscités, quitte à ce que la syntaxe soit passablement maltraitée. Or, nourri essentiellement avec la littérature des XVIII et XIXème siècle, j’attends d’un roman trois éléments : la qualité et le raffinement du style avec un véritable travail de la phrase, la profondeur des personnages pour qu’ils prennent réellement forme grâce à l’analyse de ce qu’ils sont véritablement (et en cohérence avec celle-ci) et la narration, l’art de construire et de conduire une histoire.
Une peinture d’âme
Il y a quelques années, une vendeuse de la Fnac ayant compris ce que j’aimais, me permis de découvrir une grande dame. J’achetais un livre à la fois élégant et subtil et la séduction fut immédiate. D’autres suivirent et le même plaisir réapparut, tant et si bien qu’aimant discuter avec les auteurs que j’apprécie, je finis par trouver l’adresse de cette femme à Bruxelles et m’apprêtais à lui écrire, dans l’espoir de pouvoir la rencontrer et échanger avec elle. Mais c’est à cet instant que j’appris par la presse son décès, le 24 mai 2012. J’en fus profondément attristé. Je voudrais aujourd’hui lui rendre hommage. Cette femme, c’était Jacqueline Harpman.
Née à Bruxelles, elle vécu de 1940 à 1945 à Casablanca. La guerre finit, elle revint en Belgique et entrepris des études de médecine qu’elle dut interrompre un long moment puis abandonner après avoir contracté la tuberculose .
En 1954, elle s’adonne totalement à l’écriture et rencontre l’éditeur René Juillard. Son premier roman est publié en 1958. S’ensuivirent ensuite pas loin d’une trentaine d’ouvrages dont certains furent primés, en particulier par le Prix Médicis en 2006.
En 1967, elle entreprend des études de psychologie et entre en 1976 à la Société belge de psychanalyse. Ses romans parlant essentiellement de relations entre des personnes, la psychologue et l’écrivain œuvrent alors de concert, chacun enrichissant l’autre, la première fouillant ce qui se passe dans la tête des gens tandis que l’autre expose ces analyses et les fait s’entrecroiser avec une rare élégance et un réel sens de la phrase.
Cet entrelacement donne à ses personnages de fiction un aspect réellement humain : on les voit, on les comprend, on les observe dans leurs joies et leurs douleurs, leurs certitudes et leurs hésitations. Et on les suit jusqu’à avoir la délicieuse impression que ces êtres là réellement sont vivants, ce qui témoigne de son talent.
De tous ses romans, et après une sévère sélection, j’en ai retenu trois méritant vraiment le détour.
La Plage d’Ostende
Un roman d’amour étonnant où les personnages, comme souvent, ont un ôté un peu excessif – ou passionnés pour être plus juste. Un résumé succinct (mais omettant l’essentiel) serait : une jeune fille tombe éperdument amoureuse d’un peintre talentueux et cherche par tous les moyens à captiver son attention. Sauf que Emilienne a 11 ans et que Léopold en a 25. Sauf que l’intrigue se déroule dans la société mondaine bruxelloise du milieu du XXe siècle et fait songer, dans son évocation, à ce que Proust fit dans sa recherche du Temps perdu : l’ambiance des salons, la codification particulière des manières d’être, les jeux de pouvoir, tout un apparat étincelant et distingué qui cache à peine les rivalités que se livrent les femmes pour plaire à des hommes. Le livre ressemble à une grande toile dessinée dans une infinie gamme de gris d’une exquise subtilité, comme une lumière qui émerge au dessus d’une nappe de brume. Les personnages sont évoqués au travers des arcanes de leur psychologie et décrits dans leurs moindres complexités, ce qui leur confère une réelle consistance; chaque scène, chaque paysage, chaque émotion étant détaillé avec une délicate précision à la manière du pinceau d’un grand maître.
L’histoire est forte et nous emporte, on y plonge et on s’en délecte. Quant au style, il est d’une élégance que l’on rencontre trop rarement et qui ajoute au plaisir.
Ce que Dominique n’a pas su
Ce livre a quelque chose de particulier. Pour ceux qui ont lu « Dominique » d’Eugène Fromentin, il est encore plus fort. En effet, Jacqueline Harpman en reprend ici l’histoire mais pour nous en donner avec brio une autre version grâce à un angle nouveau. Tout ce que Dominique avait vécu et raconté est à présent abordé du point de vue de Julie, soeur de Madeleine.
L’histoire apparaît simple : Julie, sans comprendre pourquoi, est amoureuse de Dominique (qui ne la remarque même pas) lequel l’est de Madeleine qui ne s’en rend pas vraiment compte et épouse Alfred qui la traitera « comme une fille de ferme ». Tout l’art de Jacqueline Harpman est de nous faire revisiter cette histoire avec un autre regard empli de finesse et de sensibilité.
Julie est terriblement attachante, observatrice sans concessions, rebelle et en heurt constant avec les impératifs du « savoir-vivre ». Elle vient nous livrer des confidences que le « héros » n’a semble-t-il pas perçu ni seulement imaginé. Dès le début, Julie nous prévient en déclarant que Dominique est « un homme aux idées étroites qui se croit large d’esprit car il a souffert ».
Ces analyses subtiles confèrent aux personnages une vraie profondeur et les « seconds rôles » (notamment le père et le cousin) ont une présence réelle et indispensable. Au-delà de la qualité narrative, Jacqueline Harpman témoigne d’une parfaite maîtrise de la syntaxe, offrant pour un pur bonheur de lecture, une écriture soignée et distinguée enchâssée dans le XIXème siècle avec quelques pointes de modernisme.
On se laisse emporter par cette histoire où l’on (re)découvre ce que furent les contraintes que s’imposât à elle-même une certaine société à une époque donnée et ce culte de la pureté et de la fidélité comme vertus cardinales jusqu’à en arriver à une hypocrisie malsaine. Julie ajoute, parlant de sa soeur et de son amant putatif : « Il y a eu ce moment terrible où elle a senti qu’elle succombait : le sot aurait du la prendre par la taille, la jeter sur ses épaules et partir avec elle, au lieu de quoi, il n’a pris que son chapeau, ses gants et la porte. Elle ne s’en est jamais remise ». Tout est dit là, dans ces mondanités et apparences trompeuses qui servent de transfuges aux souffrances et solitudes de ces êtres en quête d’un idéal amoureux et ne font que l’effleurer, de loin.
Ces pages sont délicieuses et il apparait certain que Fromentin aurait applaudi à la revisite de son œuvre !.
Moi qui n’ai pas connu les hommes
Titre singulier pour un livre magistral ! Et non, le mot n’est pas trop fort. S’il existe un roman étonnant qui ne donne pas la clé du mystère et finalement, en crée bien d’autres, c’est celui-ci !
Bien que l’écriture demeure soignée, je n’y ai pas toujours retrouvé le plaisir strictement littéraire des autres ouvrages. En revanche, j’y ai dégusté le plaisir d’une analyse particulièrement fine et juste des personnages et un sens du récit vraiment jubilatoire, même si l’histoire a quelque chose d’oppressant tant on finit par se laisser prendre par son étrangeté.
L’une des puissances de ce livre, c’est la possibilité de le lire à plusieurs degrés. On peut y voir un roman de quasi science-fiction. On peut y trouver le thème de l’angoisse face à l’inconnu. On peut songer à une sorte de thriller qui, jusqu’au bout, ménage ses effets. On peut en retirer un essai sur les relations surréalistes que les êtres peuvent tisser entre eux. Ou encore un essai de psychologie sur le thème de la solitude et de l’altérité, mais aussi de la créativité.
On peut également – et c’est le degré de lecture que j’ai finalement adopté – y voir comme un conte philosophique sur les interrogations (dont beaucoup demeurent sans réponse….) de l’Homme par rapport au monde et par rapport à l’existence. Une sorte de « qui suis-je, d’où viens-je, où vais-je » revisité, en y ajoutant, entre autres, quelques pincées du fameux mythe de la Caverne et une gorgée de celui de Sisyphe.
A la réflexion, s’il y a quelque chose d’oppressant, voire d’angoissant dans l’histoire de l’héroïne,, c’est peut être parce qu’il n’existe aucune réponse au « Pourquoi ». Dès lors, le « Comment » devient vide de sens. Il est difficile ou même impossible d’accomplir quelque chose privé de sens. Si ce quelque chose, c’est l’existence, voilà pourquoi cette sourde angoisse ressurgit de toutes les pages. Sans but, sans perspective et donc sans prospective, (sans rêves ?), le « vivre l’instant présent » devient tâche irréalisable ou plutôt, invivable Comme une quête impossible qui rend le livre à la fois enthousiasmant et bouleversant. On continue d’y songer bien longuement après avoir tourné la dernière page.
Tout l’art de Madame Harpman pourrait se résumer ainsi : elle sait peindre les âmes. Et ses histoires viennent nous habiter.


























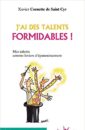











Publier une Réponse
Votre adresse email reste confidentielle.