Lorsque nous surmontons ce qui aurait pu nous tuer, gagnons-nous en force ? Ou conservons-nous, au fond de notre être, une fragilité ? Devenons-nous plus aguerri ou plus vulnérable ?
Voyons donc si Nietzsche avait raison ou s’il s’est trompé ou encore, s’il a été excessif dans ses propos.
Une alternative existentielle
En 1888, Friedrich Nietzsche publie « Le crépuscule des idoles » dans lequel se trouve cette phrase, ô combien célèbre et si souvent (trop souvent ?) répétée : « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. »
Elle est régulièrement assénée à une personne en plein marasme (affectif, psychologique, financier, physiologique ou autre) ou en détresse comme une manière de lui dire : bats-toi, surmonte ton problème et tu en sortiras grandis. C’est facile à dire quand on n’est pas concerné par un problème et qu’on ne le vit pas avec ses tripes. Mais, profondément, qu’est-ce que ça veut dire ?
Dans un premier temps, cette assertion parait signifier que chaque évènement difficile rencontré est comme une occasion de se dépasser et conséquemment de devenir plus fort. Certains vont même ajouter que c’est la Vie ou Dieu ou carrément l’Univers qui nous envoie cette épreuve. A chacun ses croyances.
Mais le souci, c’est que nous voici enfermé dans une alternative, voire un dilemme : devenir «plus fort » ou mourir. Faut-il choisir et n’existe-t-il que ce choix ? Notre existence peut-elle être contenue dans ce choix ?
Des interrogations multiples
A ce stade déjà, trois interrogations majeures :
Que l’aphorisme nietzschéen concerne un évènement difficile, pourquoi pas si cela évite de se lamenter, de se victimiser et de « se noyer dans un verre d’eau ». Encore qu’il faille déterminer : « difficile » par rapport à quoi ? Par rapport à qui ? Voire pour qui, chacun d’entre nous ayant sa propre définition et son propre ressenti de ce qui est difficile ou pas.
En revanche, s’il s’agit d’un évènement particulièrement douloureux ou carrément atroce, l’assertion demeure-t-elle pertinente ? Peut-on même avoir seulement le droit de la dire à une personne en souffrance ? N’est-ce pas une manière subtile de faire naitre une culpabilité ?
En second lieu, est-il utile ou indispensable de rencontrer des difficultés ? La souffrance est-elle légitime ou même nécessaire ? La vie n’est peut-être pas « un long fleuve tranquille », certes mais doit-elle pour autant être une « vallée de larmes » ?
Dit autrement, doit-on pour vivre – et pour bien vivre sa vie – être confronté à la souffrance ? D’aucuns diront qu’elle est inévitable et même nécessaire. Soit. La vie devient donc une succession d’épreuves qu’il faut surmonter. Et pourquoi la vie ne serait-elle pas plutôt une succession de joies à savourer ? Conceptuellement, lorsque la vie fut créée, n’aurait-elle pas pu l’être sous cet angle ?
Enfin, et en suite logique, pourquoi faut-il être plus fort ? Là aussi, nécessité ? Obligation ? Qui donc a estimé qu’il devait en être ainsi et pour quelle(s) raison(s) ? Le but de la vie est-il d’être fort et courageux et si la vie est quelque chose à vivre, pourquoi faut-il être fort pour l’apprécier ? Qu’est-ce qui, fondamentalement, permet de positionner la force au rang des vertus ?
Il ne s’agit pas ici de répondre à toutes ces questions (il y faudrait un livre !) mais de s’interroger sur une phrase si régulièrement répétée, comme une évidence (qu’elle n’est pas). Sans compter que l’on pourrait également s’interroger sur le sens même de la souffrance, d’un point de vue ontologique tout autant que spirituel.
Une phrase à manier avec précaution
On risquerait presque d’aboutir à un étonnant (et impossible) paradoxe : la phrase de Nietzsche deviendrait l’apogée d’une philosophie du dolorisme ! Néanmoins demeure la question : la souffrance surmontée serait-elle la porte nécessaire vers le bonheur, la sérénité, l’ataraxie ?
Abordons-la rapidement sous d’autres angles. Physiologiquement d’abord. De ce point de vue, cette maxime apparait fausse. Songeons tout simplement à l’affaiblissement progressif de toutes les fonctions organiques du fait du vieillissement du corps. Songeons également aux caractéristiques de dégénérescence de la maladie d’Alzheimer. En quoi une volonté forte pourrait-elle triompher des forces destructrices de l’être ?
Certes, on peut objecter qu’avec de telles maladies, on est déjà comme entré dans la mort, on est déjà dans quelque chose qui nous tue. N’oublions pas cependant quantité d’autres affections qui ne nous tuent pas mais nous laissent, même après guérison, une fragilité qui est à l’opposé même de ce qui « nous rend plus fort ».
Certains s’adaptent, comme après un accident grave par exemple, entrainant paralysie partielle ou totale. Mais une adaptation ne signifie pas une plus grande force : tout ce qui était possible auparavant ne l’est désormais plus et définitivement. L’assertion nietzschéenne peut quasiment apparaitre comme une insulte à tous ceux qui souffrent.
Sous prétexte d’aider une personne en souffrance, de la « secouer », soyons délicat pour ne pas devenir comme un bourreau la confrontant à ce qu’elle n’est pas.
Une force fragile ?
Psychologiquement le débat est plus subtil car il est question de « degrés » devant prendre en compte infiniment de paramètres. : ce qu’est la personne, ses croyances, sa maturité, son environnement, son positionnement à l’égard de la vie, etc.
Certaines se relèvent après une épreuve et acquièrent une puissance d’être. Pour ne citer que deux grandes figures, songeons à ce que Viktor Frankl avait conceptualisé avec la logothérapie ou Boris Cyrulnik avec la résilience afin de contrer une vulnérabilité liée à une histoire traumatique. Il n’en demeure pas moins que la résilience n’est pas un processus pérenne et contrairement à ce que l’on peut croire couramment, elle ne s’assimile nullement à une espèce de nouvelle « compétence » acquise définitivement.
Et puis, il en est qui certes se relèvent mais conservent au fond d’elles-mêmes, consciemment ou pas, une faiblesse. C’est le cas, par exemple, de certaines formes de dépression. La psyché ne peut pas s’assimiler à un morceau de cuir qui se tannerait au fur et à mesure qu’elle reçoit des chocs pour devenir plus souple, plus durable et plus solide.
Autant de personnes, autant de ressentis
Dans un monde où la force serait assimilée à une vertu, ne pas l’acquérir devient une faiblesse coupable, un manque de volonté, une capitulation honteuse qu’il importe de cacher au mieux. D’où cette tendance à montrer un « paraitre » solide pour camoufler un « être » fragile. Paraitre, c’est ce qui se laisse voir sans nécessairement être le pur reflet de ce qui est….
On voit qu’il est important « d’arrondir les angles » de la phrase de Nietzsche et qu’elle ne peut avoir de valeur absolue.
Une épreuve peut effectivement être une manière de mieux connaitre soi-même et l’essence de son existence et nous faire passer alors de la dimension psychologique à une dimension spirituelle et/ou philosophique. De ce point de vue, la surmonter devient une possibilité de grandir. Elle nous rend « plus fort » en nous permettant une vision plus large, en nous aidant à distinguer l’essentiel de l’accessoire ou du superflu dans nos manières d’être, de faire et d’avoir. C’est comme une sorte d’apprentissage d’un lâcher-prise existentiel.
En revanche, la même épreuve chez un autre individu, qui l’appréhendera différemment selon ce qu’il est à l’instant où il la subit, peut être une fragilisation. Cela signifie qu’il n’est pas immunisé contre un nouveau coup dur. Une épreuve surmontée n’est pas un vaccin. Cela peut aussi être une destruction, parfois très lente qui ne rendra pas plus fort mais laissera une extrême vulnérabilité ou même tuer à petit feu.
Imaginons une maison à l’extrême bord d’une falaise attaquée par la mer. A l’issue d’une forte tempête, une partie de la falaise s’est effondrée mais la maison est toujours là. En apparence, tout est encore solide. Mais la fragilité est là. Il suffira peut-être d’une seule vague, inoffensive et tranquille pour qu’un jour, falaise et maison s’effondrent définitivement et l’on s’étonnera qu’un évènement aussi anodin ait une telle conséquence, comme une application de l’effet papillon d’Edward Lorenz.
Il existe, pour chaque individu en particulier, un seuil maximal de souffrance qu’il peut endurer. Largement en dessous de ce seuil, il surmonte et en retire davantage de « force ». Un peu en dessous, il surmonte aussi mais demeure fragilisé. Un peu au dessus de ce seuil, la souffrance n’est plus constructive mais handicapante. Et largement en dessus, elle devient destructrice.
L’épreuve comme ouverture
Concluons avec deux autres considérations. Tout d’abord, nous ne sommes pas monolithiques et sauf certains cas qui relèveraient plus de la pathologie, personne n’est constamment fort et solide ou constamment faible et fragile dans tous les domaines de sa vie. Nous sommes un panachage de tout cela selon une alchimie complexe appartenant à chacun.
L’aphorisme nietzschéen est trop absolu. Sa charge émotionnelle renvoie à une idée de succès, certes très valorisante mais sa prédiction est partiellement fausse (ou partiellement juste) car il est des cas où« ce qui ne tue pas » est loin de rendre plus fort.
N’oublions pas enfin, une autre approche : une certaine fragilité peut aussi nous donner une certaine force en ce sens qu’elle peut ouvrir à une sensibilité plus vive et plus attentive à la souffrance d’autrui. En cela, elle nous rend humain, plus humain.

























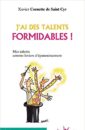











Publier une Réponse
Votre adresse email reste confidentielle.