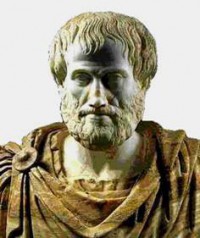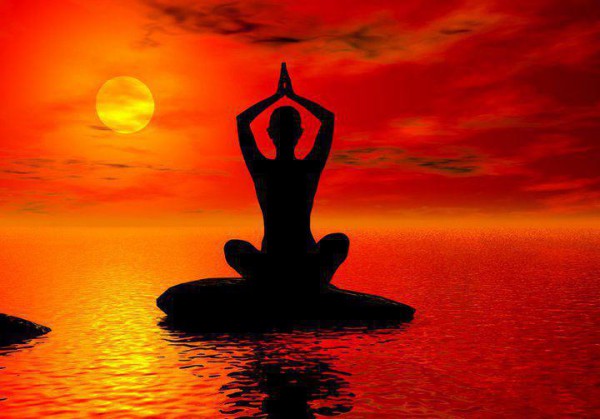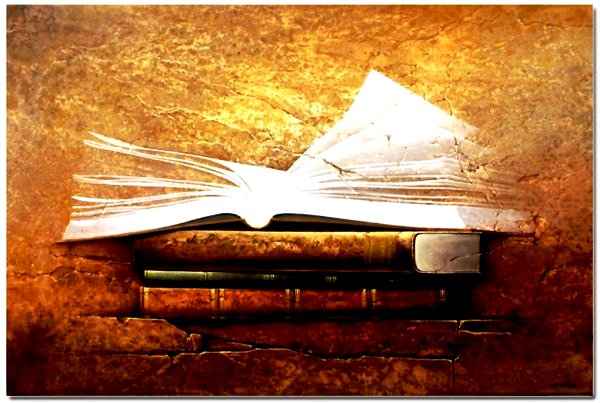Le sens de la vie… Combien de livres et d’articles sur ce sujet mais où bien souvent sont confondus (volontairement ?) donner du sens à La vie et en donner à Sa vie. Soit on s’oriente vers une approche philosophique ou métaphysique, soit on ramène la personne à des considérations psychologiques pour orienter son existence en fonction de valeurs à vivre.
Le fameux triptyque « Qui suis-je ? D’où viens-je ? Où vais-je ? » est souvent brocardé et cependant, il révèle une interrogation profonde, parfois douloureuse.
Les questions existentielles
En nous interrogeant sur ce que nous sommes, nous voici confrontés à la menace du non-être : être rejeté, ressentir l’isolement, affronter la maladie et, in fine, rencontrer la mort. Cette confrontation génère de l’anxiété car elle pointe le danger de notre existence même ou bien des valeurs sur lesquelles nous fondons celle-ci.
Ce qui est insidieux, dans ce que l’on appelle couramment l’angoisse existentielle, c’est qu’il n’existe parfois aucun élément déclenchant. Ce sont les questions soulevées par l’esprit qui la crée lorsque leur surabondance débouche sur une absence de réponses définitives.
Il existe l’anxiété liée à la mort elle-même. Quitter quelque chose de manière absolue crée nécessairement une tentative d’y échapper, surtout si ce quelque chose est notre existence. Le vouloir-vivre, dont Schopenhauer a tant parlé, se cogne durement à la réalité de notre finitude. On songe à ces mots, sans doute apocryphes, de la comtesse du Barry en 1793 qui, à l’instant d’être guillotinée, eut cette dernière supplique : «Encore un moment, monsieur le bourreau» !
Il existe aussi les interrogations sur le devenir : que se passe-t-il ensuite ? Toute une panoplie de réponses a été donné, depuis les conceptions matérialistes d’un « retour vers le néant » jusqu’aux religions décrivant les aspects d’un paradis (ou d’un enfer). Doutes, refus, espoirs, chacun se situe selon ses propres croyances.
Qu’est-ce que l’Homme ? Et pourquoi ?
La vraie question ne serait-elle pas : Quelle est la raison pour laquelle j’existe ? Qu’est-ce que cela signifie ? Car l’on présuppose qu’il y a une raison à cela. De cette présupposition découle le questionnement sur : Que puis-je faire (ou que dois-je faire) de ma vie ? Quelle mission est la mienne ? Sans raison aucune, alors la contingence reprend tous ses droits et avec elle, l’absurde envahit notre conscience.
Quand il y a inadéquation entre la quantité de questions posées et le peu ou l’absence de réponses tangibles, nait alors une anxiété pouvant être intimement douloureuse. Fier d’être un « roseau pensant », l’Homo sapiens doit cependant reconnaitre ses limites étroites.
Le biologiste Jean Rostand a médité avec pertinence sur la mort promise de l’Homme : « L’espèce humaine passera, comme ont passé les dinosaures et les stégocéphales. Peu à peu, la petite étoile qui nous sert de soleil abandonnera sa force éclairante et chauffante. Toute vie cessera sur la Terre qui, astre périmé, continuera de tourner sans fin dans les espaces sans bornes. Alors, de toute la civilisation humaine ou surhumaine( …), rien ne subsistera(…) En ce minuscule coin d’univers sera annulée pour jamais l’aventure falote du protoplasma. Aventure qui déjà, peut-être, s’est achevée sur d’autres mondes. Aventure qui, en d’autres mondes peut-être, se renouvellera. »
Voilà posée la question essentielle de la philosophie : Qu’est-ce que l’Homme ? Pourquoi l’Homme, pourquoi existe-t-il ?
Kant, parmi beaucoup d’autres philosophes, a apporté sa pierre à l’édifice en distinguant trois grandes sous-parties à sa réflexion : Que puis-je savoir ? Que dois-je faire ? Que met-il permis d’espérer ? Ces trois questions répondent à la « grande » question par le biais de la connaissance, de la morale et enfin, de la religion. Kant a rédigé une somme intellectuellement parfaite. Mais émotionnellement ? Au fond de soi, la partie inquiète est-elle satisfaite ?
Prendre conscience
Pour une prise de conscience, il suffit de regarder un ciel étoilé. On suppose qu’il y aurait environ 250 milliards de galaxies dans l’Univers, chacune d’elles contenant quelques centaines de milliards d’étoiles. D’où l’affirmation logique qu’il y a autant d’étoiles dans l’Univers que de grains de sable sur Terre !
Prendre conscience que notre planète n’est qu’une infime poussière parmi tant d’autres dans cette immensité infinie, que l’Homme n’est pas le centre de l’Univers, qu’il n’est pas un aboutissement mais un simple chainon de tout un processus d’évolution et que la finalité même de ce processus d’évolution demeure un mystère, voilà de quoi donner le vertige…. « Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie » disait Pascal.
Quelle solitude face au cosmos ! Quelle insignifiance aussi ? Et que d’incertitudes quant à notre existence, notre place dans le monde, notre devenir, le sens de notre vie et le pourquoi de la vie. Pourquoi la Vie existe-t-elle ? L’angoisse existentielle, c’est cette difficulté de vivre avec tant d’incertitudes.
Il arrive que l’humour soit un moyen d’alléger (temporairement) le poids de ces questions. « S’il existe une vie ultérieure, et s’il y en a une, peut-on m’y faire la monnaie de vingt dollars ? » se demandait ainsi Woody Allen,
Les questions du sens donné à sa vie, à ses choix
La vie de nos parents ou grands-parents pouvait s’appuyer sur un principe de linéarité : il n’y avait qu’un nombre limité de choix à faire et, une fois qu’un choix était fait, dans sa vie privée ou professionnelle, il fallait s’engager à fond dans l’aboutissement logique de ce qui était programmé, projeté par ce choix.
Or, aujourd’hui, plus rien n’est linéaire et l’instabilité oblige à d’incessants choix et réajustements réguliers avec remise en cause ou éloignement des grandes références religieuses, morales, politiques ou autres. Et nous remettons régulièrement les choses en questions : Quelle nouvelle direction prendre ? Ai-je raison ou vais-je le regretter ? Quels sont les choix que je devrais faire et puis-je les faire ? Quel est le sens que je veux donner maintenant à ma vie ?
La grande tentation est de fuir dans la distraction qui est proposée à chaque instant. Très bien quand cela est apaisant et mesuré, plus fâcheux quand c’est une fuite permanente : on se remplit d’activités souvent insignifiantes, on encombre sa vie pour échapper à soi et surtout, on se détourne de toute réflexion jusqu’au jour où l’on s’y retrouve confronté de manière brutale et soudaine. Cette abondance de distractions crée de la superficialité qui finit par nous emplir …. de vide !
De nouveaux choix à faire
Le bilan de vie peut intervenir lors d’un évènement changeant radicalement la donne : « Ais- je fais ce que je voulais faire ? Cela a-t-il vraiment du sens, pour moi ? ». On décide de faire le point pour mieux voir où on en est et où on va. On interroge le temps passé, celui qui passe et celui qui reste ; ce que l’on décide soi-même aujourd’hui va déterminer demain. Devenir responsable de soi est un premier pas. Il est essentiel.
Ces questions et réflexions concernent bien évidemment d’autres domaines de vie : vie sociale, vie sentimentale, vie de couple, rôle de parent, etc. Elles se résument à : « En tenant compte de ma situation actuelle, que puis-je faire et quel avenir puis-je construire pour être mieux ? ».
Ces changements ou étapes décisives dans la vie peuvent être envisagées comme une bonne occasion de se réorienter, à condition de travailler sur soi pour se défaire de son anxiété. [1]
Certains trouvent leurs réponses dans diverses sagesses (spiritualités, religions, philosophies, …), pour d’autres cela ne suffit pas ; la grande difficulté est d’apprendre à accepter que notre vie terrestre puisse se dérouler sans recevoir nombre de réponses. La toute puissance et l’omniscience ne nous appartiennent pas.
L’accepter, c’est lâcher-prise sur un faux contrôle.
C’est source d’une grande libération pour se réorienter vers un meilleur-être, une quiétude salvatrice et une ouverture à ce qui nous environne.
C’est se mettre en action pour construire ce que nous croyons être le plus juste, le plus adéquat.
C’est retrouver et bâtir sa confiance à être.
Comme un chemin vers son authenticité.
[1] Pour en savoir plus et trouver des réponses individuelles, voir « Sortir de l’anxiété – Mode d’emploi » par Xavier Cornette de Saint Cyr et Mona Poisson – Editions Jouvence, septembre 2014.