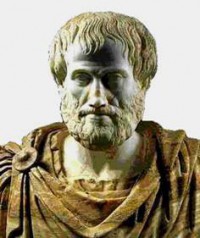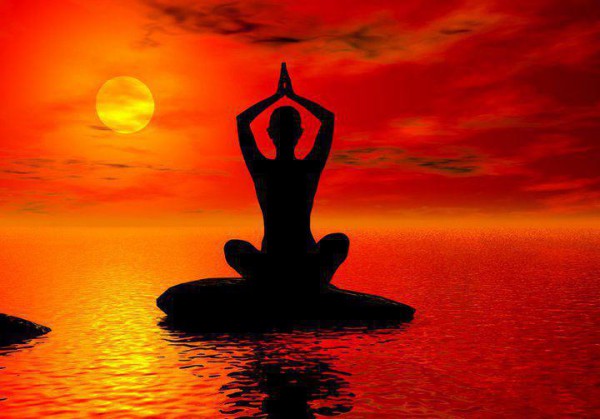Au pays de Descartes, nous nous revendiquons rationnel. De surcroit – et bien souvent sans le savoir – nous sommes aussi aristotélicien. Et oui ! Quand nous affirmons quelque chose d’absolu et que nous estimons qu’elle est ainsi et ne peut pas être différente, nous appliquons le principe du tiers exclu d’Aristote. Ce faisant, nous ne simplifions pas toujours nos discussions et par voie de conséquence, nos relations.
Voyons-en les effets dans notre communication pour comprendre comment il impacte notre système de pensée et nos rapports aux autres.
La logique d’Aristote
Aristote est un philosophe grec du IVème siècle avant notre ère. Sa logique repose sur trois principes qui continuent de régenter notre manière de penser et de voir le monde. Ce sont :
1/ le principe d’identité : tout ce qui est, est.
2/ le principe de contradiction : rien ne peut à la fois être et n’être pas.
3/ le principe du tiers exclu : tout doit ou bien être, ou bien ne pas être. »
Voyons ce qu’ils signifient :
1/ Le principe d’identité : A est A , d’où le postulat suivant : « tout ce qui est, est ». Réciproquement, non A est non A et « ce qui n’est pas, n’est pas ». C’est simple à saisir : ce qui est vrai est vrai ou ce qui est faux est faux, etc. Cela permet de la cohérence en donnant de la permanence aux choses que l’on désigne. Le mot « livre » doit toujours désigner un livre. A défaut, nous ne pourrions plus communiquer.
Le souci, c’est d’appliquer ce principe partout, surtout dans un monde de complexité. Par exemple, si je dis « Une proposition vraie est vraie » (sous-entendue « reste vraie »), il y a risque de figer une pensée, sauf à démontrer que la proposition elle-même n’est plus vraie du fait d’un changement de contexte ou d’autres paramètres. Du coup, l’application de ce principe donnerait « une proposition fausse est fausse ». C’est donc l’approche contextuelle qui permet de valider (ou d’infirmer) la validité de la proposition émise selon ce principe.
2/ Le principe de contradiction : A n’est pas non-A. En effet, « rien ne peut à la fois être et ne pas être, une proposition ne peut être vraie et fausse en même temps ». Là aussi, facile à comprendre : ce qui est vrai n’est pas faux ou ce qui est faux n’est pas vrai ou encore, ce qui est juste n’est pas injuste, etc.
« Il est impossible, déclare Aristote, qu’un même attribut appartienne et n’appartienne pas en même temps et sous le même rapport à une même chose ». Le point important est la prise en compte de l’instant où la proposition est exprimée.
On ne peut affirmer et nier la même proposition au même moment. Si ce que je dis maintenant est vrai mais s’avère faux demain, cela ne remet pas en cause le principe car nous ne sommes pas au même instant. Ce qui est visible maintenant ne le sera plus tout à l’heure ou ce qui est vivant présentement sera mort à un moment donné. Mais il est impossible selon Aristote que ces déterminations s’appliquent simultanément et que ce qui est vivant soit en même temps mort et que donc, qu’à la fois une chose soit et ne soit pas. A est bien différent de non A.
3/ Le principe du tiers exclu : A est vrai et Non-A est faux (et réciproquement). Mais de plus, il n’y a pas de milieu entre A et non-A. Soit une chose est, soit elle n’est pas. Une proposition est donc soit vraie, soit fausse ou, dit autrement, de deux propositions contradictoires, l’une est vraie et l’autre fausse.
On ne peut attribuer que deux « états » à une affirmation : soit son état, soit son contraire. Il n’existe pas de troisième état « intermédiaire ». Appliqué à un objet physique, ce principe se tient : soit il pleut, soit il ne pleut pas. Il ne peut pas pleuvoir « un peu ». S’il n’y a juste que quelques gouttes, eh bien il pleut ! Appliqué à ce que nous ressentons, c’est déjà plus compliqué. Idem si nous appliquons ce principe à un concept moral. Puis-je dire : une chose est soit bonne soit mauvaise ? Oui dans certains cas et non dans d’autres….
Cette logique est vraie ou fausse ?
Nous utilisons en permanence ces trois principes sans nous en rendre compte et sans même en connaitre les noms. Ils ont créé une logique qui a fondé une conception dualiste, laquelle a tout structuré, en Occident en tout cas : notre langage, nos modes de pensée, nos croyances et nos comportements. Et ce, depuis l’antiquité jusqu’à maintenant.
Poser la question de savoir si la logique d’Aristote est vraie ou fausse montre bien l’ambigüité du principe du tiers exclu dans un monde régie par la complexité.
Le problème, c’est que ce sont en fait des principes mathématiques et la mathématique est souvent décrite comme étant la seule vraie science, celle qui établit des vérités intemporelles, voire éternelles. Or, Aristote les a présentés comme régissant « les lois de la pensée » et de fait, nos mécanismes de pensée fonctionnent selon ces principes. Parfois, c’est très bien et parfois, ça nous pose de sacrées difficultés. On comprend mieux les Normands avec leur habitude de dire « ça dépend » !
Par exemple, le principe de non contradiction n’est pas toujours évident ! Aristote l’a posé comme une nécessité absolue et en plus comme un axiome, c’est à dire une vérité première qui démontre d’autres vérités et qui ne peut pas être démontrée (à cause de son caractère premier). Partant de là, les sciences se sont développées en faisant l’hypothèse que le principe du tiers exclu est exact mais ce principe n’est en fait qu’une hypothèse non démontrée.
Près d’un siècle avant lui, Héraclite ne l’aurait pas accepté, lui qui s’attachait à l’unité et à l’indissociabilité des contraires : « Toutes choses naissent selon l’opposition… » ou « Le changement est une route montante-descendante et l’ordonnance du monde se produit selon cette route… ». Lao-Tseu, de même, s’attachait aux complémentarités des contraires au lieu de les considérer comme des oppositions.
Aristote et nos vies quotidiennes
Lorsque nous parlons aujourd’hui de coopération dans les entreprises, ce ne sont pas les principes d’Aristote que nous devons utiliser mais ceux de Lao-Tseu (ou d’Héraclite, surnommé d’ailleurs « le Lao-Tseu grec »). En effet, la coopération, c’est de trouver à partir de deux visions différentes ou opposées une troisième voie qui permette d’atteindre l’objectif fixé. En revanche, les négociations qui échouent sont celles qui appliquent à la lettre le principe de non contradiction.
Quant à la physique, qui s’éloigne parfois de la mathématique, elle n’est pas à l’aise du tout avec les principes d’Aristote. En thermodynamique par exemple, ou en mécanique quantique, comment comprendre la nature de la matière. Onde ou particule ? Masse ou énergie ? C’est bien le souci majeur du fameux chat de Schrödinger dont on continue d’ignorer selon la logique d’Aristote s’il est vivant ou pas alors qu’il se pourrait fort bien, selon la logique quantique, qu’il soit les deux en même temps.
Revenons à nos relations entre humains. Imaginons un manager utilisant avec son collaborateur (ou un parent avec son enfant), le principe du tiers exclu : « Soit tu es capable de faire telle chose, soit tu n’en es pas capable ». S’il l’applique très strictement, il ne comprendra pas qu’on puisse lui répondre « Je sais le faire à moitié » ou bien « je peux en faire une partie ». Nous avons vu que s’il pleut un peu, ça veut dire qu’il pleut. Aussi, si quelqu’un peut faire un morceau du travail, c’est que donc il est capable de faire la totalité. Tout aussi bien une vision plus négative considèrerait que s’il ne peut pas faire la totalité, il ne peut pas faire du tout. Caricature ? Jeu de l’esprit ? Observons juste certaines réactions de certaines personnes !
Les sites de développement personnel sont friands d’injonctions aristotéliciennes. La dernière que j’ai vue est ainsi libellée : « Dans la vie, tu as deux choix le matin. Soit tu te recouches pour continuer à rêver. Soit tu te lèves pour réaliser tes rêves ». Autre exemple, une citation de Eckhart Tolle : « Lorsque vous vous plaignez, vous faites de vous une victime. Quittez le situation ou acceptez la ». On pourrait en citer mille autres. C’est gentillet, un peu simpliste, un tantinet moralisateur et c’est toujours le « soit/soit », démontrant combien Aristote envahit toutes nos pensées !
Alors, que se passe-t-il avec ces principes ?
Ces principes ont induits un certain nombre de mécanismes de pensée qui ont des conséquences sur nos rapports humains.
Le principe d’identité déjà pose problème en calquant une vision statique alors tout est mouvement. Dire « tout ce qui est, est », appliqué à la lettre, vrai peut être dans l’instant, va à l’encontre de la vie si on l’étend car il empêche le devenir. Nous risquons de plaquer sur les gens des jugements, des images que nous considèrerons à la fois comme justes, vraies et …définitives. Nietzsche avait cette parole fameuse : « Deviens ce que tu es » qui implique un dynamisme. Le monde, les êtres, les objets, nous-mêmes, rien n’est figé, tout évolue. Les bouddhistes disent à raison que la seule chose permanente, c’est l’impermanence !
Tous ces principes, fortement ancrés dans notre culture, nous ont « habitués » à raisonner en termes de valeur et donc à évaluer avec certains critères. C’est porter des jugements sur lesquels nous plaquons des concepts de qualité par couples opposés : « vrai » et « faux », « bien » et « mal », « juste et « injuste ». Or, ce sont là des notions abstraites, non définies, à géométrie variable et subjective et s’appuyant sur une référence non précisée. « « Vrai » par rapport à quoi ? Rien de tel pour engendrer des conflits puisque chacun en a une perception ou une définition différente.
Nous constatons d’ailleurs que l’Histoire, même actuelle, est traversée de conflits dans lesquels les partisans du Bien vont guerroyer contre les partisans du Mal. Le principe du tiers exclu nous fait croire que lorsque nous devons faire un choix, nous n’avons à notre disposition que deux possibilités opposées, une « bonne » et une « mauvaise », que ce soit dans nos vies professionnelles ou personnelles. On attend un « oui » ou un « non ». Que faisons-nous alors de la négociation ? Cela crée une sorte de barrière mentale et nous rend plus difficile l’accès à de multiples choix. Cela crée aussi des polémiques puisqu’avec un raisonnement « soit / soit », chacun va vouloir persuader l’autre qu’il a tort puisque lui, il a raison !
Rapportons enfin cette logique à la question du sens, immense source de mal-être et de questionnements sans réponses satisfaisantes. L’existence a-t-elle un sens ou n’en a-t-elle pas ? La vie est-elle intelligente ou absurde ? Dieu existe-t-il ou non ? Nous pourrions décliner cela à l’infini. Le problème, c’est qu’à chaque fois, nous n’avons le choix qu’entre une chose et son contraire (ou son opposé).
Faut-il inclure ou exclure ce tiers ?
La logique classique est ancrée sur ce principe du tiers exclu et nous avons été instruits sur ces bases là. Ne le rejetons pas absolument car il démontre très souvent sa grande utilité.
Cependant, sa limite apparait dès lors que la complexité croit. Gardons-le pour le « courant », les situations simples et abandonnons-le dès qu’un problème devient, non pas compliqué, mais complexe.
Le monde fonctionne rarement sur un système binaire et nos relations de même. Les principes d’Aristote, justes dans une logique mathématique, s’accordent mal avec un environnement où tout est nuances. J’avais écrit il y a peu un article « Relativisme et tolérance » dans lequel je présentais la doctrine du syadvada, tout à l’opposé de ce dualisme. Les séances de « brain-storming », les travaux « cerveau droit / cerveau gauche » sont des exemples de cette sortie d’un schéma de pensée binaire qui n’est plus opérant quand surgit la complexité.
Et lorsque nous sommes face à autrui, gardons-nous de ce réflexe : il a tort ou il a raison. Exercice délicat et si souvent salutaire pour l’harmonie de nos relations !