Tout est vain sauf la bonté.
Auteur/autrice : Xavier Cornette de Saint Cyr
-

Apprendre à sourire
Prendre soin de soi recouvre infiniment d’actions et « techniques ». Le sourire en fait partie. Il est d’une grande importance dans nos relations avec les autres… et avec nous-mêmes.
Comment se porte le sourire ?
« Le sourire se porte été comme hiver ; tout devient gris quand on le perd » chantait Salvatore Adamo : il illumine autant le visage qui l’exprime que la personne à qui il s’adresse.
C’est une expression qui tend des muscles aux deux coins de la bouche et autour des yeux. Dans un sourire, ce sont 17 muscles qui travaillent ensemble et simultanément. Ce qu’exprime le sourire est le plus souvent le plaisir, le contentement, la joie l’amusement mais il lui arrive également de désigner l’ironie.
Le psychologue américain Paul Ekman, l’un des pionniers à étudier les émotions dans leurs relations aux expressions faciales, en a souligné le rôle social. Il a donné une explication fondée sur les micro-expressions du visage où il distingue deux types de sourires : le vrai, involontaire, qu’il nomme aussi sourire de Duchenne et le faux, volontaire qu’il nomme également sourire social ou sourire Pan American.
Pourquoi « sourire de Duchenne » ? Un siècle auparavant, vers 1850, le neurologiste Duchenne de Boulogne réalisa des expériences sur l’expression faciale de l’émotion et nota que la différence entre un vrai sourire et un sourire forcé réside dans la contraction non seulement du zygomatique mais aussi d’un muscle situé autour des yeux : l’orbicularis oculi.
Vers 1980, Paul Ekman confirma ces résultats : nous serions quasiment incapable de contracter volontairement cet orbicularis oculi et en tout cas, pas de chaque côté au même moment. Dans le sourire volontaire ou forcé, seul le zygomatique serait contracté. La perception de cette micro-expression permet de savoir si la personne est dans la sincérité ou la façade.
Les empreintes culturelles importent, même dans le sourire. En effet, si le sourire volontaire est également nommé sourire social ou sourire Pan American, c’est qu’aux Etats-Unis, il doit montrer aussi bien les dents du haut que celles du bas. Il suffit de regarder certaines affiches de publicité ou des photos de « stars » pour s’en apercevoir.
Dans la culture européenne, française entre autres, ce type de sourire est perçu comme factice car trop appuyé. Il donne l’impression d’une publicité pour dentifrice et est reçu comme non sincère. Pour un américain lambda, le sourire d’un français, plus mesuré, apparaîtrait probablement comme gêné, emprunté, et ne témoignant donc pas de sentiment ou d’émotion suffisants. La micro-expression dont parle Ekman a toute son importance, bien que perçue inconsciemment. Car, en plus du sourire en tant que tel, il y a tout ce qui l’accompagne et que nos « capteurs » détectent : attitude globale, posture, regard, pertinence du geste dans la communication, etc.
Les bienfaits du sourire
Pour reprendre la chanson de Salvatore Adamo, « Le sourire ne coûte que le plaisir de l’offrir» et c’est bien là que se trouve sa puissance. Dans le même ordre d’idée, l’écrivain et journaliste Raoul Follereau (connu aujourd’hui en France pour la fondation qui porte son nom afin de lutter contre la lèpre et la pauvreté) écrivait : « Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup. Il enrichit celui que le reçoit, sans appauvrir celui qui le donne ».
Ces mots sont essentiels : en souriant à l’Autre, nous lui faisons un cadeau. Cadeau d’un instant mais qui enrichit aussi celui qui donne. Quand on ne sait plus sourire, on entre alors en grande pauvreté, témoin d’une souffrance et il est nécessaire d’en recevoir pour réapprendre. Un vieux proverbe chinois l’exprime parfaitement : « Nul n’a plus besoin d’un sourire que celui qui n’en a plus à offrir ». Donner un sourire à quelqu’un qui l’a perdu, c’est faire preuve d’une belle générosité et dont la valeur vient de ce qu’il se donne.
Cultiver son propre bien-être demande aussi de développer celui des autres. Le sourire en est la première pierre sur laquelle s’échafaude notre contentement. Il est une joie offerte ; offrir cette joie n’est possible que si on l’éprouve soi même et plus on en donne, plus elle s’accroit. Mère Teresa disait avec infiniment de justesse : « Nous ne saurons jamais tout le bien qu’un simple sourire peut être capable de faire»
Dans son Journal, Jules Renard notait cette jolie phrase : « Rides, des sourires gravés». Dans une époque où les crèmes anti-rides sont constamment vantées, n’oublions pas que beaucoup de celles parsemant un visage sont la trace des sourires d’autrefois ; ce sont les plus belles.
Il est si simple et agréable d’adresser un sourire quand on dit bonjour, quand on remercie, quand on demande quelque chose, quand on quitte quelqu’un. En relation professionnelle ou amicale, dans un magasin, au restaurant ou un transport en commun, il est le sésame qui ouvre bien des portes. Même au téléphone, effectué avec sincérité, il « s’entend » et influe légèrement mais positivement la tonalité de la voix.
Il favorise les relations, à telle enseigne que spontanément, nous allons bien plus facilement vers une personne souriante que vers celles qui sont renfrognées. Et les personnes sincèrement souriantes sont réellement beaucoup plus belles et séduisantes.
Une dernière citation pour achever ces quelques lignes sur le sourire et ses bienfaits. Elle est de l’Abbé Pierre et son énoncé même prête déjà à sourire : « Un sourire coûte moins cher que l’électricité, mais donne autant de lumière. ».
S’il y a des exercices de musculation quotidien à effectuer, ce sont ceux qui favorisent les zygomatiques et l’orbicularis oculi !
Rien n’est plus triste qu’un visage qui ne sait plus sourire.
-
Quitter la vie
Il faut quitter la vie comme Ulysse quitta Nausicaa : en la bénissant et non amoureux d’elle.
-

L’attachement comme cause de la souffrance
La fragilité de nos attachements
La Deuxième Noble Vérité exposée par Bouddha est : « dukkha samudaya ariya sacca », c’est-à-dire : la cause de la souffrance est l’attachement.
Ce qui engendre souffrance est l’ignorance et surtout le désir, l’avidité, la cupidité, la soif (soif des plaisirs des sens, soif de l’existence et du devenir et soif de la non-existence). L’attachement n’est pas la cause première ni l’unique cause de la souffrance mais elle en est la principale, la plus répandue.
Cette soif, c’est le désir et l’attachement. C’est celle des sens, de la jouissance mais aussi celle du pouvoir, de la puissance, de la richesse (richesse en tant que volonté presque maladive de possession et qui traduit en fait une bien triste pauvreté de soi). C’est suivre nos pulsions, sans frein ni discernement, parce qu’on en a envie, parce qu’on le veut, le désire. C’est aller à la jouissance directement sans recul ni réflexion, c’est confondre la liberté et le fait de donner libre cours à ses caprices du moment. C’est positionner le « je veux » comme un impératif à satisfaire immédiatement. Force est de constater qu’au-delà de la satisfaction du plaisir immédiat, on n’en est pas nécessairement plus heureux.
Il ne s’agit nullement de bouder tout plaisir mais de constater que lorsqu’il est dirigé de manière purement égoïste, égotique et auto-centrée, il ne débouche pas sur quelque chose de vraiment épanouissant, loin s’en faut. Tout ce qui a la possibilité d’apparaître à un moment donné porte en lui la possibilité de disparaître à un autre moment. Chaque présence porte en elle-même son absence. Ephémère, impermanent. C’est ce que rappelle un texte pali, le Majjhima-nikaya, en déclarant : « Tout ce qui a la nature de l’apparition, tout cela a la nature de la cessation ».
Qu’est-ce que la suppression du désir selon Bouddha ?
Il importe de bien comprendre ce que Bouddha veut dire et d’éviter des mésinterprétations. S’il s’agissait de supprimer tout désir, nous parviendrions alors à une pensée nihiliste. Quand Bouddha parle de supprimer le désir, il vise ce qu’il appelle la soif. Dans cette optique, le désir est vu comme manque et la soif est bien un manque. L’essence du désir ne réside pas dans le manque. On peut bien éprouver le désir de boire sans pour autant avoir nécessairement soif. Ce qu’il vise ici, c’est le désir générateur de manque. Lorsqu’il parle d’avidité ou de cupidité, c’est bien de cela dont il s’agit. Ce point là est capital pour ne pas voir en Bouddha le destructeur passionné des passions ou le chantre du non-désir absolu !
Le terme « Samudaya » regroupe également l’attachement que l’on a à des idées, des principes, des idéaux, des opinions, des théories et des croyances. C’est cette soif qui est à l’origine de tous les conflits qui peuvent exister entre les humains, depuis la querelle de voisinage ou la dispute au sein d’une famille jusqu’aux rivalités et guerres sanglantes entre des nations. Il y a un désir avide couplé à un manque profond ; cela génère du conflit. Comme en chimie : la mise en présence de deux composants spécifiques crée une réaction. On est esclave de cette soif disait Bouddha, de cet attachement qui dégénère dans un désir de possession. Cet attachement crée un lien, une dépendance d’une chose avec une autre ou d’une chose sur une autre. Si ce lien ne s’établit pas ou s’il se rompt, ou bien si l’une de ces choses disparaît, alors naît la souffrance. La jouissance espérée, le plaisir convoité n’intervient pas ou disparaît ou s’arrête. A sa place, il y a un manque.
Cela ne peut qu’entraîner de la souffrance : Il y a dukkha quant il y a manque.
Nos attachements multiples
Quand on dit « je veux ceci » et qu’on ne l’obtient pas ou bien, quand on déclare « on ne doit pas…. » et que cela se fait malgré tout, on est dans l’attachement à une chose ou à une idée qui n’intervient pas comme on le souhaite et on en éprouve nécessairement de la contrariété, de l’agacement, de la colère. Au lieu du plaisir attendu, on éprouve un manque, une incomplétude. Il y a apparition de dukkha.
Multiples sont les situations où dukkha peut apparaître. Car multiples sont nos attachements à quelque chose ou à quelqu’un. Avec divers degrés qui impliquent donc diverses souffrances, de celle qui est juste gênante à celle qui est ressentie comme absolument insupportable.
Ce qui est cause de la souffrance, ce n’est pas le désir en soi. C’est l’attachement que l’on a, l’attachement au désir, le fait de vouloir à tout prix se saisir de quelque chose et le refus de s’en dessaisir.
Prenons un exemple. un objet auquel je tiens m’est volé. Ce vol entraîne l’obligation, contre mon gré, de m’en dessaisir ; j’en ressens alors une souffrance. L’attachement que j’ai pour cet objet crée à présent un manque.
Autre exemple : je fréquente une personne que j’apprécie infiniment mais qui me quitte. Son départ entraîne l’obligation, contre mon gré, de me séparer d’elle; j’en ressens alors une souffrance. L’attachement que j’ai pour cette personne crée à présent un manque.
Il n’est pas pour autant question d’être entièrement détaché de tout et de chacun et de vivre sans la moindre émotion à la manière d’un robot. C’est à la fois plus simple et plus complexe. Il est question de montrer que la cause des souffrances que nous ressentons trouve son origine dans l’attachement, générateur de manque. Lorsqu’il ne peut se faire ou qu’il est rompu, il crée du manque. C’est pour cela que l’attachement est la cause de la souffrance.
Quand nos propres pensées créent un manque
Cet attachement, cause de souffrance, est fondé sur une conception perfide due à l’ignorance. En effet, de par cette ignorance, nous voyons le monde comme fractionné en une multitude de choses individuelles, différentes et distinctes et nous cherchons alors à les catégoriser, à les faire entrer dans des structures fixes que bâtit notre intellect. Cette représentation compacte omet les liens d’interdépendance de ces choses et s’appuie de plus sur la croyance en leur fixité et en leur persistance. De fait, nous nous y attachons alors que leur nature même est d’être changeante et en quelque sorte, « fuyante ». C’est pourquoi à l’ignorance se rattache l’illusion.
Frijtof Capra, dans son ouvrage « Le Tao de la physique » écrit fort justement : « Aussi longtemps que prévaut cette conception, nous restons condamnés à aller de frustration en frustration. Essayant de nous accrocher aux choses que nous voyons comme si elles étaient fixes et persistantes, alors qu’en fait elles sont transitoires et toujours changeantes, nous devenons prisonniers d’un cercle vicieux où chaque action engendre une action ultérieure, et où la réponse à chaque question pose de nouvelles questions. »..
Les pensées que nous produisons sont le fruit de nos désirs, de nos craintes et nos espoirs. Le bouddhisme ajoute aux cinq sens que nous connaissons un sixième qui est le mental. Celui-ci crée des pensées qui elles-mêmes n’ont d’autre choix (ou fonction) que de construire des images, des concepts et des théories. Ces deniers viennent s’interposer entre nous et le réel. Rechercher la réalité dont parle Bouddha, c’est parvenir à ôter ce filtre.
Mais en même temps, toutes ces représentations que nous avons et qui bâtissent l’image que nous avons du monde ont un rôle qui est d’assurer notre sécurité. Sécurité car donnant l’impression d’une certaine maîtrise, d’un savoir et donc d’un pouvoir. Voilà pourquoi nous nous y accrochons, viscéralement.
Cette sécurité dépend des illusions que nous formons et auxquelles nous voulons croire. L’inconvénient, c’est qu’elles ont un prix, celui de la souffrance quand elles vacillent sur leur socle instable. Par exemple, La chute du mur de Berlin (« mur de la honte » à l’ouest et « mur de protection antifasciste » à l’est) en novembre 1989 a pu provoquer chez certains une souffrance : la pérennité d’un système idéologique s’achevait en un tas de gravats. De même, on peut supposer qu’en France, la loi Combes (Loi de séparation des Églises et de l’État du 9 décembre 1905) a pu provoquer chez certains une souffrance : vingt-cinq ans d’affrontements idéologiques parfois violents prenaient fin dans la promulgation d’une loi. A chaque fois, un processus similaire : la souffrance dû à l’attachement à une pensée s’intercalant entre soi et la réalité.
Une prise de conscience salvatrice
Quand ce sont nos pensées qui créent ce manque, nous pouvons donc nous rendre compte que nous sommes nous-mêmes à l’origine de la souffrance. Si nous pensons par exemple que notre conjoint ne devrait pas dire ceci et notre enfant faire cela ou notre collègue (ou tout autre personne) se comporter de cette manière, c’est bien que nous avons une idée selon laquelle il faut dire ou agir de telle manière et non pas de telle autre. Du coup, cela crée en nous colère, énervement, indignation, etc. Bref, tout un lot d’émotions négatives, tant pour soi que pour cet autre.
Ne peut on pas alors, dans chaque situation, se demander si la personne agit réellement mal, si elle a intrinsèquement tort ou bien, si c’est notre conception du il faut/il ne faut pas qui est erronée ou inadaptée ?
Ne peut on pas en ce cas simplement s’interroger sur le fait que, parfois, nous créons notre souffrance nous-mêmes, tout seul, et que cela n’est peut être pas utile ?
Ne peut on pas également s’interroger sur la pertinence de tous les il faut/il ne faut pas et on doit/on ne doit pas dont nous émaillons notre langage et nos pensées ? Sont ils vrais, sont ils justes, sont ils nécessaires ?
Ce questionnement ne saurait à lui seul tout résoudre. Mais nombreuses sont les situations où il nous aide à retrouver de l’apaisement.
-

Le bonheur est dans la vertu
Au IVème siècle av. J.-C, les philosophes grecs se sont grandement interrogés sur cette question : comment être heureux ? Étrangement, en ce début du XXIème siècle, la même question réapparait avec force. Avons -nous, aujourd’hui, trouvé quelque chose de nouveau ? Revenons donc à cette sagesse antique dont nous avons finalement tant à apprendre.
La naissance d’une philosophie eudémonique
A la fin de l’indépendance d’Athènes, une vingtaine d’années après la mort d’Alexandre, Zénon de Cittium vers 301 av J.C. crée le stoïcisme aussi dénommé la Philosophie du Portique : il réunit ses premiers disciples sous un « portique » (stoa en grec), galerie couverte ayant des colonnes ou des arcades supportant le plafond (l’Epicurisme étant appelé la Philosophie du Jardin). Grâce à ses qualités intellectuelles et morales, Zénon développe avec succès sa pensée.
Le stoïcisme est une philosophie dite eudémonique (du mot grec « eudémonia » : le bonheur). En effet, le bonheur de l’individu en est le point central, il est placé comme but ultime de la vie. C’est d’ailleurs une constante des écoles philosophiques de l’époque : il s’agit de définir une manière de vivre heureux – un art de vivre pourrait-on dire. Pourquoi ? Parce que la morale est une réflexion qui cherche à déterminer la nature du bien. Le bien, c’est ce qui est fondamentalement désirable pour l’homme, par opposition au mal, qui est à rejeter. La morale a pour but de réaliser le bien ou le bonheur. Les deux finissent presque par se confondre.
Le début de la période hellénistique
Il n’est pas possible d’étudier un courant philosophique sans prendre en compte le contexte de sa naissance et de son développement, les influences réciproques laissant leurs empreintes.
Aussi, lorsque le monde est devenu instable et que la cité grecque se retrouve soumise à ses conquérants, la finalité politique telle que le prônaient certains philosophes comme Platon ou Aristote est foncièrement transformée. La République rêvée n’est plus de mise. Les Grecs se forgent alors une pensée dans laquelle ils peuvent trouver une manière de résister à tous ces bouleversements. Dans un premier temps, le glaive l’a emporté sur l’esprit et désormais, on doit s’appuyer sur ses propres forces ; il n’est plus possible d’être en attente des bienfaits de la vie politique et le principe instaurant des liens entre l’individu et la cité est maintenant un principe ancien.
En effet, à l’heure où nait le stoïcisme, la Grèce a perdu depuis peu son indépendance. Athènes, qui a connu son apogée en 427 av. J.C., sort ruinée de son conflit avec Sparte (Guerres du Péloponnèse.). La Grèce s’effondre ensuite face aux troupes de Philippe de Macédoine puis de celles de son fils, Alexandre le Grand, qui parachèvent son accaparement avant l’arrivée des légions romaines en 197 av. J. C. Cette période d’un siècle et demi, entre la fin de l’Empire macédonien avec la mort d’Alexandre en – 323 et l’arrivée de Rome, sera appelée période hellénistique.
Avant que Philippe de Macédoine n’impose sa victoire, Athènes a donc connu une sorte d’âge d’or que ce soit dans le théâtre, l’architecture, les sciences, la philosophie ou la démocratie. Des personnes illustres comme Eschyle, Sophocle, Périclès, Démocrite, Socrate ont marqué son histoire en profondeur. Il y a de quoi avoir l’impression d’un paradis perdu et d’une époque définitivement achevée. Les belles constructions d’un Platon ou d’un Aristote ont vécu. La recherche du bonheur individuel n’en est que plus cruciale. Les attaches civiques antérieures s’étant rompues, l’individu est renvoyé à sa liberté ; celle-ci lui commande de s’adapter à ce nouvel environnement et de se forger ses propres règles de vie.
Le monde grec va quand même en profiter pour enrichir sa pensée de toute la culture venue d’Orient et d’Egypte. Période délicate et complexe sur le plan idéologique mais certainement pas décadente, tout au contraire, la pensée hellénistique prenant peu à peu de plus en plus de vigueur. C’est d’ailleurs à cette époque que vont apparaitre trois grands systèmes philosophiques d’importance qui vont être prédominants : l’épicurisme, le stoïcisme et le scepticisme.
Aussi, le stoïcisme, s’il peut être vu comme une philosophie de temps de crise, n’est en aucune manière une philosophie de réconfort et de guérison mais bien plutôt l’affirmation d’une pensée forte et puissamment orientée vers un comment vivre et davantage encore, vers un bien vivre.
La quête du bonheur
Dans ce IVème siècle av. J.-C, le problème que se posent les grecs se résume donc à : comment être heureux ?
Cette question, à la différence de notre époque, est le centre de la philosophie. Aristote voit d’ailleurs le bonheur comme un mode de vie rationnel et vertueux. « Le bonheur est un principe ; c’est pour l’atteindre que nous accomplissons tous les autres actes » écrit-il. Très schématiquement, la réponse à cette question consiste en 2 points : servir sa cité en étant un citoyen courageux et en payant ses impôts et être fidèle aux dieux. Avoir le sentiment profond du devoir accompli et d’avoir agi dans le droit fil de la nature, c’est cela qui permet d’atteindre l’apatheia, c’est à dire l’absence de troubles, la non-souffrance.
Le stoïcisme pose à son tour la quête du bonheur individuel comme déterminante : il appartient à chacun de chercher et d’accomplir son salut, d’où son individualisme. Il déclare également que c’est l’univers qui constitue le cadre au sein duquel le bonheur peut s’insérer, d’où son cosmopolitisme : il touche à l’universalité, il concerne tout le monde. C’est ce que l’on retrouve souvent dans la philosophie hellénistique : la quête de l’harmonie entre soi et soi, entre soi et les dieux et entre soi et la cité.
Pour bien saisir la place de la Nature, il faut comprendre que tous les stoïciens s’accordent sur une idée majeure : l’homme n’est pas en face de la nature, ni au-dessus ou en-dessous d’elle, mais bien en son sein même. C’est là qu’il peut être heureux et non plus, comme précédemment, parmi les hommes de sa cité. Vivre conformément à la nature est un postulat essentiel du stoïcisme, que Zénon et Chrysippe posent, que d’autres reprennent ensuite et qu’Epictète va rappeler avec intensité, constamment et sous de multiples formes.
La liberté d’être heureux
Parmi un certain nombre de concepts qui émaillent la pensée d’Epictète, certains plus fondamentaux se dégagent. En voici quelques uns qui, aujourd’hui, méritent amplement d’être médités.
Vivre selon la nature. La vertu consiste à connaître la nature et à vivre en harmonie avec elle. La nature qui est visée n’est pas celle des écologistes mais l’univers, le monde, la réalité. Le monde est comme un grand organisme, une sorte de vivant éternel qui s’assimile à Dieu, lui-même ordonnateur du monde. Il existe donc une notion de destin à l’encontre duquel volonté et intelligence humaine sont impuissantes. Il en résulte qu’il n’y a pas de totale liberté d’action de l’homme (ce qui n’empêche nullement – loin de là ! – une liberté de pensée).
Cultiver sa liberté intérieure : la liberté de pensée. « Cherchons nos biens en nous-mêmes, autrement, nous ne les trouverons pas » dit Epictète. Le monde est donc un organisme où tout se tient et la vraie liberté consiste à agir selon l’ordre du monde. Il ne dépend pas de moi. En revanche, ce qui dépend de moi, c’est mon attitude devant cet ordre du monde.
Le sage n’est pas dans une acceptation passive et conformiste de l’ordre de la nature ; il y a chez lui un vouloir actif de cet ordre. Il est donc libre quand il est maître de sa volonté en décidant absolument de toutes ses pensées, opinions et représentations. Il veut ce qui est comme il est.
Au contraire, le fou veut ce qui ne dépend pas de lui ; il est fou quand il refuse cet ordre et se révolte contre lui en voulant changer ce qu’il n’est pas en son pouvoir de changer.
Le bonheur est dans la vertu : vivre conformément à la nature, c’est diriger notre vie conformément à la raison. Cela n’a rien à voir avec la satisfaction de nos tendances naturelles comme l’envie, la convoitise, l’ambition, la cupidité, la vanité ou l’égoïsme.
Le bonheur ne peut se trouver que dans la vertu, c’est-à-dire dans une relation juste aux choses, à telle enseigne que bien et vertu sont indissociables. La passion est une déraison car elle provient d’un désaccord avec la nature ; elle est une erreur de jugement.
Epictète ne demande pas de l’absolutisme car on entrerait soit dans la contrainte (opposé au bonheur) soit dans un idéalisme abstrait (indéfini et inatteignable). Il vise la dimension pratique. En conséquence, si l’on ne peut atteindre la pleine sagesse, il convient de s’en inspirer par des conduites dites convenables, c’est-à-dire le plus proche possible de ce qui est souhaité, le plus possible en harmonie avec le monde, la Nature.
Il est fort probable que les stoïciens, et Epictète notamment, avaient compris que la sagesse est un idéal accessible en théorie mais inaccessible concrètement. Aussi, il importe de s’en approcher le plus que l’on peut.
A défaut du parfait, on recherche le meilleur.
-
Le domaine de la philosophie
Le premier domaine de la philosophie et le plus indispensable, c’est la mise en pratique des principes.
-
Le choix de la sérénité – Benoît Saint Girons
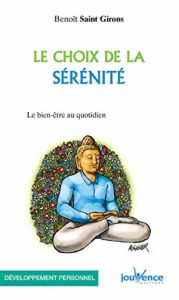 Lecture savoureuse ! Combien de fois me suis-je dit : « Tiens, c’est exactement ce que je voulais dire ». Et de plus, je me suis régalé des très nombreuses citations qui l’émaillent.
Lecture savoureuse ! Combien de fois me suis-je dit : « Tiens, c’est exactement ce que je voulais dire ». Et de plus, je me suis régalé des très nombreuses citations qui l’émaillent.
La sérénité est un thème souvent abordé ; encore faut-il savoir la vivre ! Le titre lui-même est déjà une invitation à se questionner : faire un choix, c’est décider d’opter pour une direction plutôt qu’une autre. La sérénité est donc quelque chose que l’on peut décider librement d’aller quérir. Cela a l’air évident et cependant, force est de constater que tout le monde, malheureusement, ne se pose pas la question en ces termes.
Par ailleurs, ce petit livre explique parfaitement combien nous sommes dans une époque qui la recherche tout en fonctionnant de manière telle qu’on s’en éloigne. Il importe donc d’en prendre conscience pour ensuite modifier légèrement le curseur et se rapprocher davantage de la plénitude tant désirée.
La dénonciation est une chose, il y a après le chemin à parcourir. Celui-ci est facilité par des propos emplis de légèreté et en même temps, d’humilité, celle de celui qui, pragmatique, sait parfaitement qu’il « dérape » parfois, ne détient aucune vérité mais fait partager ce qu’il a découvert en respect de ce qu’il est, de l’Autre et en conscience. Cette conscience qui permet de se dire « tiens, là, j’ai dérapé » et ainsi pouvoir, peu à peu, pas à pas, progresser vers du plus être.
Une invitation douce et bienfaisante à faire fonctionner ses neurones et son cœur pour un bien-être au quotidien. Autant y répondre, on ne peut qu’y gagner. -
Découvrir un sens à sa vie – Viktor Frankl

Le titre de ce livre n’est peut-être pas le plus approprié. Non, il ne dit pas comment trouver un sens à sa vie. (et qui pourrait le dire ?) Mais il donne des clefs particulièrement intéressantes et incite à une profonde et fructueuse réflexion par le biais de la logothérapie dont il est l’initiateur.
Nous avons coutume de privilégier le consumérisme et le matérialisme. Quand on dit d’une personne qu’elle a bien réussie sa vie, on songe souvent à une belle carrière avec divers honneurs et certaines finances. Et pour beaucoup, « bien vivre » équivaut à faire régulièrement l’acquisition de multiples biens. Or, il arrive un jour où on se pose la question du « pourquoi » ? Albert Camus l’avait abordé dans « Le mythe de Sisyphe ». Viktor Frankl la décline ici à partir de son propre cheminement et de ce qu’il découvrit tout autour de lui.
Ce psychiatre autrichien est malheureusement très peu connu en France alors que sa pensée est d’une telle richesse ! En synthétisant, on peut dire que Freud a fondé sa théorie sur la pulsion sexuelle (en demandant aux autres d’aller travailler sur les étages supérieurs : cœur et âme), qu’Adler a mis en exergue la volonté de pouvoir, que Jung a présenté les « archétypes psychologiques » et l’influence de l’« inconscient collectif »,et que Frankl a mis l’accent sur la volonté de sens comme motivation de l’existence.
Le « credo » de Frankl, c’est d’inciter à chercher un sens à sa propre vie pour le cultiver au quotidien. C’est pourquoi il a fondé sa propre école de psychothérapie et l’a intitulé logothérapie créé à partir du mot grec « logos » que l’on peut traduire par sens ou esprit.
Lire en parallèle Jung et Frankl permet de mettre à jour ses propres valeurs spirituelles et de s’aventurer dans cette quête extraordinaire qu’est celle du sens de notre vie en se responsabilisant sur ce sens. Nous ne sommes pas le simple jouet de nos pulsions et nous ne sommes pas non plus entièrement déterminés par notre contexte social. Nous sommes aussi ce que nous pensons de nous et de la vie. L’harmonie vient quand il y a corrélation entre nos choix et nos aspirations et le mal-être apparaît quand nous vivons à rebours de ce qui nous importe au plus haut point ou quand nous ne savons pas (ou plus) sur quels critères nous appuyer.
Au lieu de subir ce qui nous est imposé de l’extérieur, apprenons à mettre à jour et à vivre ce qui vient de nous, de notre être profond, de l’intérieur. C’est en ce sens que ce livre ouvre des voies essentielles (et existentielles !). C’est pour cela qu’il figure dans la rubrique « Spiritualité » et non dans celle de « Psychologie ».
Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, l’ouvrage d’Elisabeth Lukas « La logothérapie : Théorie et pratique » est à lire même si, d’approche plus complexe, il est plutôt destiné à des professionnels ou des amateurs avertis. -
Les Maîtres spirituels de l’hindouisme – Alexandre Astier
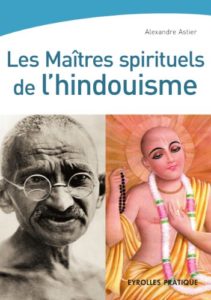
S’il est une religion complexe, pour un occidental tout au moins, c’est bien l’hindouisme, la religion aux dieux si nombreux que l’on ne saurait les dénombrer précisément !
Ce petit ouvrage est très bien fait. Il présente rapidement 17 figures majeures de l’hindouisme : leur vie, leur enseignement et leur postérité. A chaque fin de chapitre, une liste d’ouvrages pour ceux qui voudraient en savoir davantage. Parmi ces figures, on trouve Ramakrishna, Sri Aurobindo, Gandhi, Krisnamurti, Amma, et d’autres, moins connus, mais tout aussi importants pour la construction de cette étonnante spiritualité.
A lire comme introduction à l’une des plus vieilles religions du monde qui compte environ 1 milliard de fidèles. -
Transformer sa vie par la méditation – Nathalie Ferron
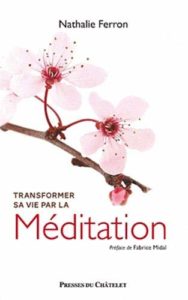
Ce livre est un régal ! Bien documenté, sensible et profond, émaillé de divers témoignages fort intéressants, il aborde avec grâce et légèreté toutes les composantes de la méditation en les plaçant dans ce que nous vivons au quotidien.
Avec une analyse très pertinente des différentes facettes de notre société, il explique et montre en toute simplicité comment la méditation peut se pratiquer et se vivre, non seulement au bénéfice de soi-même mais aussi des autres avec lesquels nous entrons en relation, que ce soit en famille, en couple, au travail, etc.